D’un flou l’autre, d’un gris l’autre, d’un souffle l’autre
D’un flou l’autre. D’un gris l’autre. D’un souffle l’autre.
Gerhard Richter avait juste treize ans lorsque Dresde fut détruite et réduite en cendres par les bombardiers alliés à l’hiver 45. Bombardiers qu’il peignit en 1963 dans ce qui allait devenir son célèbre… gris flouté.
Car Richter va longtemps peindre ses tableaux comme des photos en noir et blanc… passées… ou comme des bas de femme… filés. Ses figures y sont brossées, essuyées… effacées. Et ce, non pas comme Bacon pour tirer la peau jusqu’à la déchirer et faire ressortir la luxuriance de la chair intérieure, mais pour flouter l’image dans une vaine tentative de figer le temps qui… file. Il ne s’agit pas de la griffe fauve qui ouvre la peau mais de la griffe du… temps qui passe,… tout aussi cruelle. Et ses gris sur fond gris sur fond gris vont former comme une échelle de Richter des accrocs du temps.
Minimaliste, voire Duchampien au départ (puisqu’il ira jusqu’à peindre un simple rouleau de pécu dans une… suspension… du temps pour le moins originale et révélatrice), Richter s’essayera aussi et surtout à la photo de famille.
C’est là qu’un drame, en partie insu du peintre, ressurgit des cendres. Tremblements du passé.
Regardez sa tante, Marianne, peinte à l’âge de quatorze ans aux côtés du neveu nouveau né.
Marianne sera déclarée schizophrénique par les nazis. Stérilisée dans un premier temps afin d’éviter toute contagion (sic), elle sera par la suite purement et simplement éliminée pour inadéquation à l’idéal racial requis par le troisième Reich. Voici donc la jeune et jolie tante précieusement conservée sous gris, juste avant qu’elle ne soit totalement effacée !
Et voici sa première femme, Ema.
Elégamment floutée, cette fois en couleur mais avec cette atmosphère particulière comme due à un flash mal réglé. Une belle allemande élancée, bonne sous tous rapports, est peinte nue, descendant l’escalier (« Akt auf einer treppe » : décidément le spectre de Duchamp hante les brumes de Richter). Un idéal féminin pas si innocent que cela. Le père d’Emma, qui toute sa vie restera reconnu comme un notable, a probablement participé directement à la stérilisation et à l’élimination de la tante du peintre, en tant que médecin accoucheur et SS-Obersturmbannfürher.
Richter ne l’apprendra que bien plus tard.
Il y a aussi l'oncle Rudi... criblé de gris comme fusillé par le mur du fond avec tous ces tracés dont le corps apparaît comme traversé de partout. Raide et droit dans ses bottes, posant dans son nouvel uniforme nazi, il est certes encore debout... mais c'est comme si ces toutes ces estafilades parallèles l'avaient déjà virtuellement mis en pièces.
La couleur de gloire du peintre, ce gris étalé et brossé cache donc sous ses voiles de cendres l’insu que sait….
Mais Richter est également, à l’époque où il peint ces toiles grises,… un homme des sixties. Où le noir et blanc des magazines y est plus joyeux. Nous sommes juste avant l’explosion des couleurs pimpantes et flashy des seventies. Les premières voitures de série rapides filent littéralement (sur) les photos en dévidant la pelote du temps pressé, et Richter s’imprègne de ces femmes aux coiffures bouffantes et à franges, finement gainées dans ces fameuses robes droites à imprimés coupées au dessus du genou. Des jeunes femmes à la mode qu’il découvre au travers des magazines occidentaux après qu’il a franchi le mur… qui n’était alors qu’un épais mais dangereux écran gris de fumée puisqu’il n’était pas encore érigé (Richter passe en Allemagne de l’ouest début 1961).
De ces images heureuses des sixties je soutire un détail : une plage en bord de mer… Un soleil éclatant... Une femme en bikini (dix ans alors seulement qu’un pays tel que l’Espagne l’accepte sur ses plages). Et quand Richter ne brosse pas ses toiles pour filer le passage du temps, il plaque ses aplats de gris au couteau pour mieux saisir l’…instant, le graver dans tous ses éclats, comme ici, avec ce soleil qui taille à loisir des éclats de chair blanche entre les noirs ombreux et profonds.
On imagine une blonde aux lunettes noires très sixties.
Et dans ce jeu de plage et de cache-cache, l’œil exorbité s’égare dans les replis et les entailles ombreuses en quête d’autres plis...
Ou cherche à savourer ces tétons, ces formes coniques dont on ne se lasse pas de faire le tour, à l’instar d’un potier rehaussant d’un doigt l’encolure de son vase.
Où il s’agit bien sûr de tourner de l’œil ! Là où l’ombre s’enfonce comme un coin dans la chair féminine. Pour se loger en son giron. Qui, étymologiquement, est un pan coupé en pointe qui vient de la… lance germanique. Drôle de pan que ce tablier (avec toutes les connotations arachnéennes que l’on connaît)… pointu.
Eclats de chair! Si le verbe anglais « blow up » signifie à l’origine éclater, il servira par la suite à désigner l’agrandissement photo avant que le zoom et son zip vrombissant ne devienne d’usage encore plus courant. Mais « Blow up », c’est surtout un film magnifique d’Antonioni de 1966 où un photographe de mode réalise toute une série d’agrandissements photos pour s’apercevoir à la fin qu’il a bien été témoin d’un meurtre. C’est le toujours aussi incroyable et magique suspens du zoom. Dans l’attente de voir… Dans un grossissement aveuglant !
C’est ce photographe d’ailleurs qui à un moment saisit sur le vif une Jane Birkin nue (une première pour un film « sérieux »), toute jeune, au sourire espiègle et à la frange très sixties. Des franges qui hantent mon enfance.
Je suis toujours dans l’attente de voir l’objet du délit… au fin fond de la frange des bois… Zip !
« Viens petite fille dans mon comic strip / Viens faire des bull's, viens faire des WIP !/ Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et /…..des ZIP ! / SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! »
Mais revenons à nos grisailles. Un paysage, gris et flou, comme celui du Maryon Park de « Blow up », est souvent étrangement inquiétant.
Une fascinante nostalgie à raz de terre. Fleurs floues, bois sombre. Feuillage bruissant. Le souffle un peu frais du vent nous entourant comme dans un cocon. Un frisson nous parcoure. Le frisson c’est ce régime de la peur qui est plutôt de l’ordre du plaisir. L’horreur attendue, souhaitée et recherchée, la course poursuite enfantine, la nostalgie heureuse ou encore la ballade au clair de lune dans un muséum d’histoire naturelle entre les squelettes antédiluviens dans leur vitrine d’exposition.
A la recherche d’un côté pénombre entre chien et loup qu’éclairerait un rai de pleine lune. Comme le chante Lavilliers : « Au petit jour on quittait l’Irlande et derrière nous s’éclairait la lande ». Même si c’est le soir que la lande devient inquiétante : « … Soudain la lande s’ouvrit devant moi… entre mauve pâle et pourpre profond… Tandis que je marchais, le seul point fixe d’orientation dans cette lande sans arbres était une très curieuse villa flanquée d’une tour complètement vitrée qui me rappela bêtement Ostende… Le ciel bas couleur de plomb, le violet maladif de la lande qui finissait par vous troubler la vue, le silence bruissant dans les oreilles comme lorsqu’on écoute la mer dans un coquillage, … » Sebald.
Une lande féminine où à défaut d’une tour vitrée une commissure rose souligne l’horizon. « C’est une lande, et un chemin étroit, sans bordure ni ombre, y déroule à perte de vue ses douces courbes alternantes. L’air gris pâle est sans un souffle. On voit au loin entre terre et ciel une sorte de commissure…. » Beckett.
Où me revient mon amour pour les pontons et ces casinos vitrés que l’homme s’est parfois ingénié à construire dessus. Comme on peut en trouver sur Rügen : l’île de Caspar David Friedrich, le peintre romantique allemand par excellence. Au bout du ponton, face aux grands espaces gris bruissants.
Un ponton où je ne me lasse pas d’écouter la voix de Céline. Celle de « Mort à crédit »… lorsque le narrateur arrive en Angleterre (avant qu’il ne rencontre la superbe Merrywin) : « Il faisait déjà nuit, c’était pas très bien éclairé. C’était une station en hauteur, comme montée sur des échasses, sur des pilotis… C’était étiré, tout enchevêtré, tout en bois… . ça résonnait des mille membrures dès qu’on marchait sur la plate forme… »
Tandis qu’à Rügen le vieux germain désenchanté devant un mur de gris ne cesse, devant l’horizon, de penser à son frère mort… d’avoir brisé la glace de la Baltique.
Le flou serait-il comme une sécrétion de la nostalgie ? Son émanation parfumée.
Richter s’est ainsi essayé à la baigneuse. Une « Kleine badende » où l’on retrouve le flou passé de mode du photographe David Hamilton, comme sa passion pour les jeunes filles.
Le flou est-il là pour dénier un désir coupable ? Serait ce un voile de pudeur ?
Comme un voile de désuétude, un papier chiffonné et froissé pour bien enrober et glisser au fond de sa poche la chose, ce secret d’enfant, ce désir d’enfant et d’enfance. Un frisson froissé. Pour cacher et préserver tout à la fois. Ce n’est plus le secret comme sécrétion comme chez Deleuze mais la nostalgie comme ver à soi(e). Chrysalide.
De laquelle émanent ces premières odeurs fortes. Qui se mêlent à celles de ces maisons de famille, peu souvent aérés et chargés d’histoires.
A la recherche de l’odeur du temps perdu. « …quand au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l’iris, … défaillant, … jusqu’au moment où une trace naturelle comme celle d’un colimaçon s’ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchaient jusqu’à moi. » Un frisson incontrôlé.
Il est des choses qu’il faut enrober de brumes, qu’il faut reculer dans le lointain par « myopie calculée ».
Une chose qui exige des éclairages tamisés, une chose qui n’est belle que sous le… voile. Car il faut se protéger de son coup d’éclat ! ZIP! SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!
Mais l’homme par excellence du gris c’est Beckett. « La mer n’a guère plus de couleur que le ciel qui n’en a guère. »
Mais même dans une gangue de boue grise, il ne faut pas désespérer.
« Je m’en vais maintenant tout effacer sauf les fleurs...Rien que nous deux nous traînant dans les fleurs. »
Beckett aimait les fleurs fanées (comme une vague émotion, neutre et grise, la seule chose qui restait peut être de ses premiers attouchements avec une mère sévère). Une sensibilité à fleur de caillou. Ces cailloux qu’il aimait faire rouler au fond de sa poche. Un roulement à cailloux qui manque de liant. Une grise rugosité qui se polit avec le temps. Un doux galet. « J’aurais préféré il me semble un orifice moins sec et moins large… Enfin. Entre pouce et index on est autrement mieux. »
Florence de Mèredieu évoque dans un superbe opuscule cette pluie de roses sur l’envers du monde gris de Beckett. « Les pétales à force de joncher un sol mouillé, finirent par s’alourdir jusqu’à se transformer en un amas putride, visqueux ». De la boue de rose jonche le sol gris. Un camaïeu de gris et de roses.
Où j’imagine Rothko contemplant un de ses diptyques… rose et gris. Ou Cy Twombly nous gribouillant une rencontre mythologique tourbillonnante entre Perséphone et Hadès.
Tandis que Richter nous peint lui une énième tête de mort en peinture. Sa particularité : sur un fond Rothkoien, elle est comme posée sur une table de verre. Où le flou s’associe à la précision et la netteté d’un plan de verre. Frisson du tain.
Vanité du miroir sans fond ! L’esprit est-il un os ?
Esprit où es-tu ? Richter a réalisé quatre tableaux autour d’une annonciation du Titien. Une annonciation pour mieux nous parler de l’ineffable passage du verbe et du temps. Ou de l’effacement des choses quand la chair se fait esprit. Alors que le Titien à la fin de sa vie, dans son ultima maniera, peignait avec ses doigts et de la chair humaine (comme le croyaient ses contemporains), triturant sa pâte à mains nues, cherchant quant à lui l’esprit fait chair !
Incarnation, désincarnation dans une symphonie en rose!
L’esprit serait-il une éjaculation de rose ?
Car l’Esprit Saint de la trinité chrétienne, le « Spiritus Sanctus », vient du grec « Pneuma Hagion ». Or chez Aristote il y a une connivence certaine entre le « pneuma » et la « physis ». Baiser (et non embrasser sic !) est de nature « pneumatique » car la verge se gonfle. Or le mot utilisé par Aristote pour ce gonflement est « physao » : souffler. Or à l’origine le mot « physis » (la « natura » en latin) c’est tout autant « physis galacto », la montée de lait, que « physis petrou » l’essence/substance de la pierre. Pour la femme c’est son… sexe. « Physis » c’est la force qui nous tient au corps par le sexe (qui nous prend par le bas et nous érige). D’ailleurs la « natio » latine avant d’être une nation est… la portée (des petits). Donc on voit là que notre Esprit Saint s’est allégé au fil des traductions, en mettant de côté sa dimension libidinale, de souffle vital et sexuel.
Salvador Dali parlait d’éjaculer sur une toile. « Oune éjacoulationne ! »
Et pour continuer dans cette veine du gris-rose, je voudrais maintenant évoquer l’Amérique des fifties. Et prononcer un requiem en gris-rose pour sa grandeur perdue. Pour célébrer non pas tant sa décadence industrielle, mais une page de son passé, telle que l’Amérique sait bien en tourner.
Il faut lire « Pastorale américaine » de Philip Roth.
La couverture folio me tape dans l’œil… Cette fille en tailleur de laine long et aux socquettes fifties, aux hanches larges et généreuses (où l’on aimerait se vautrer). Un visage espiègle à la sucette à l’anis. Une « nymphette », une lolita. Comme la Miss New Jersey dont parle le livre.
La femme américaine des fifties se libère, elle s’enfile l’homme comme elle le ferait d’un bas de soie (une histoire de gant retourné parcourt en sous-main la pastorale de Roth). « Avecques du crin et du fil vous fîtes un engin viril d’un des vieux guands de votre mère et acresté à la mode antique. » C’est l’homme comme sex toy : la vraie révolution féministe.
Et cela alors qu’en parallèle l’Amérique industrielle commence son déclin (et oui dès les fifties) et que l’on va assister au fil des ans à l’étrange détérioration de villes entières, comme laissées à l’abandon pour passer, ailleurs, à autre chose. Ce qui m’étonnera toujours c’est cette capacité des américains à laisser les choses mourir sans s’en préoccuper outre mesure. Comme ces théâtres-cinémas, premiers monuments de l’ère de l’entertainment qui faisaient le plein à l’époque et que l’on retrouve aujourd’hui laissés en plan, en ruines. Comme si la vastitude du territoire, les lacs et les forêts du grand nord, faisaient que l’on pouvait laisser une ville telle que Détroit comme un musée de la ruine ! Cette Motown a perdu un quart de ses habitants ces dix dernières années et ses bibliothèques, hôtels et banques du centre ville, désertés et laissés à l'abandon, font aujourd’hui le bonheur des photographes en quête de paysage post-apocalyptique.
« … les vieilles usines noires, fabriques fonderies, cuivreries, industries lourdes qui dataient de la guerre de sécession… Des usines du XIXième qui broyaient les hommes pour produire des marchandises et qui n’étaient plus que des tombes impénétrables, étanches. Newark y était enseveli… Usines pyramides de Newark… aussi colossales, aussi noires, aussi hideusement impénétrables que les tombeaux des grandes dynasties historiques. » Philip roth.
Il nous faut terminer cette grisaille par une œuvre chinoise. Des fruits pulpeux… comme des seins en poires. Une éjaculation d’encre grise… liquide sur un fin buvard.
Si l’occident, pendant cent ans, a essayé de saisir et d’arrêter le temps avec des photos en noir et blanc figées sur papier glacé, l’extrême orient laisse quant à lui depuis mille ans l’instant s’éterniser en faisant… gicler le gris. Nature, culture. Eclat, giclure.
Chez les chinois l’encre n’est pas au pinceau ce que la couleur est à ligne en Occident. Elle est la chair qui se soutient de l’ossature tracée au pinceau. Mais chair et os restent des substances. Nous ne sommes pas dans la ligne contour qui n’existe que pour notre crayon et qui s’épure avec le temps, à la limite de l’évanescence, réécrivant l’histoire de l’Esprit Saint qui s’allège de son côté spermatique originaire.
« L’hiéroglyphe du souffle ». Une jolie expression d’Hubert Damisch. Nous sommes bien en pleine « physis » de l’encre.
Les chinois parlent d’ailleurs de l’extase de l’encre.
Les nuages soufflés, l’encre éclaboussée… Le rythme du spontané… l’influx…
Et quant à ces fameuses brumes soufflées des paysages chinois on notera qu’elles ne vont pas sans la surrection en parallèle d’étranges montagnes bien escarpées. Des pains de sucre… aux étranges conformations.

/image%2F0395736%2F201302%2Fob_9f991cc67dc89bd2746fa62af5771435_arnolfini.jpg)

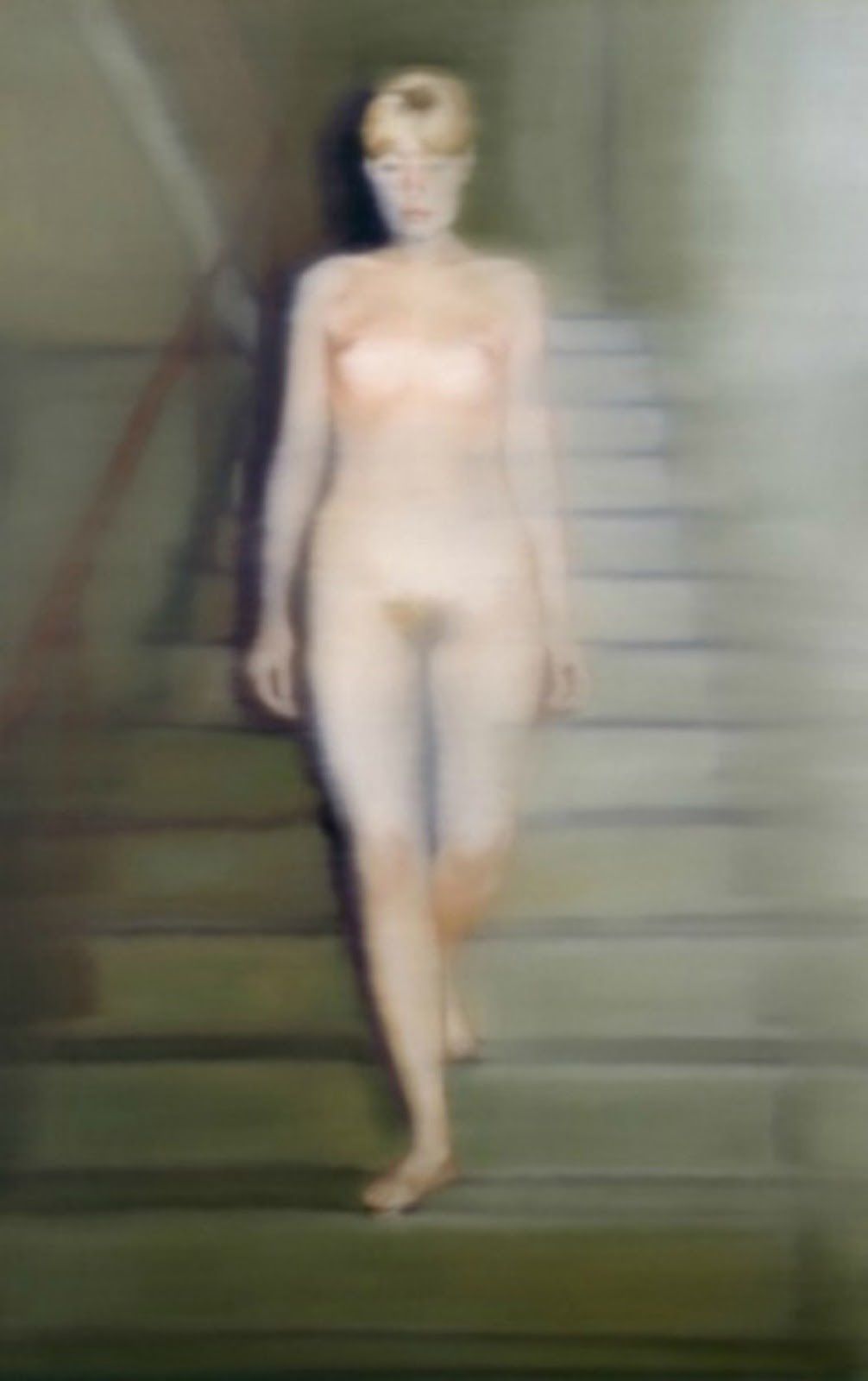




















/image%2F0395736%2F20240410%2Fob_041d52_grotte-chauvet-entre-cuisse-remastered.jpg)
/image%2F0395736%2F20231124%2Fob_bbdc51_20231025-111717.jpg)
/image%2F0395736%2F20231108%2Fob_fc42dc_psx-20231102-135326.jpg)
/image%2F0395736%2F20230907%2Fob_af1dac_20230820-165903.jpg)